François Bayrou, un « boomer » qui a fait « pschitt »
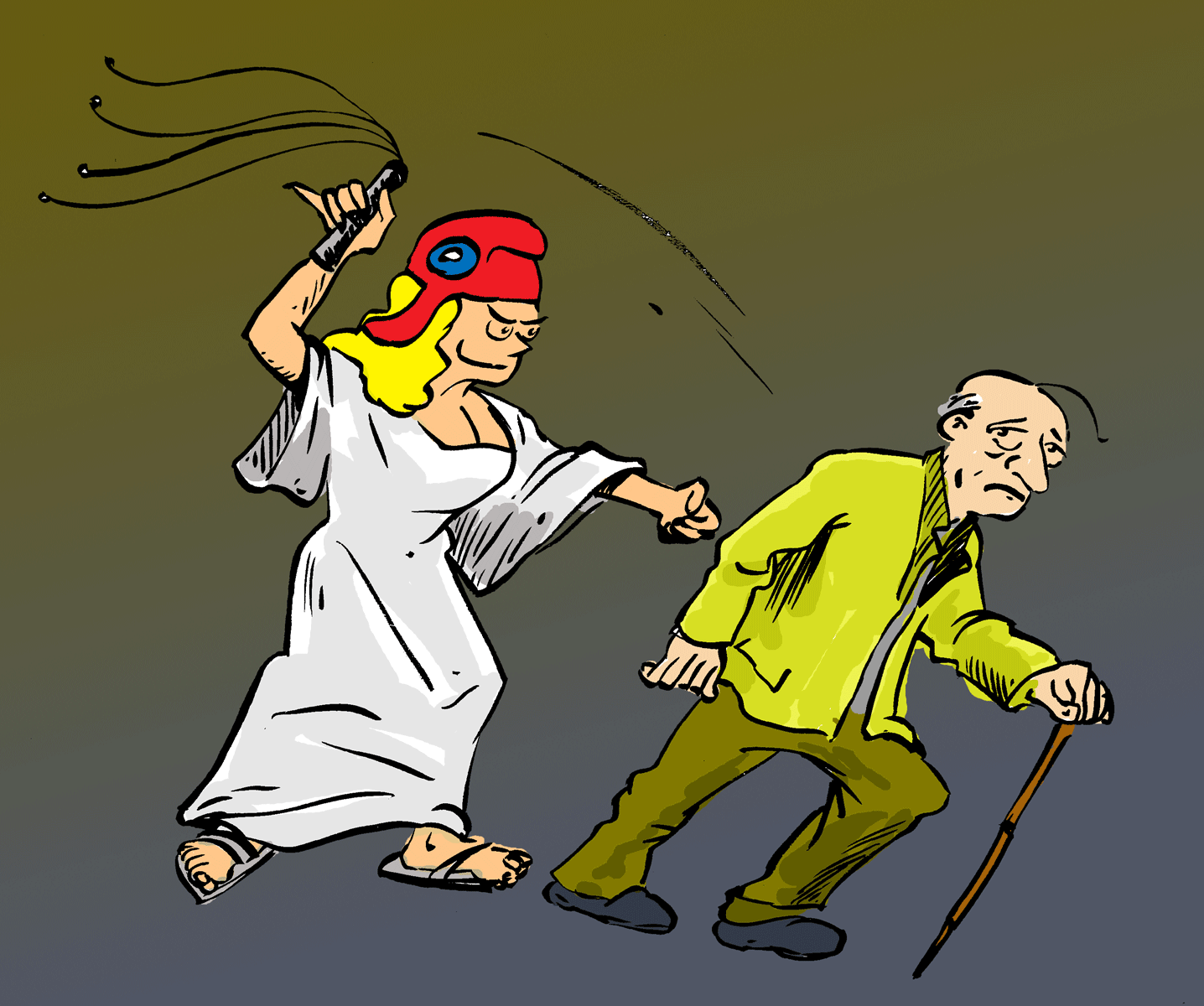
Le 27 août, François Bayrou, reçu au journal télévisé de Gilles Bouleau sur TF1, a déclaré (sans souci de la syntaxe) à propos de la gigantesque dette publique française : « Les premières victimes, c’est les plus jeunes des Français (…) C’est eux qui seront les victimes, c’est eux qui devront payer la dette pendant toute leur vie, et on a réussi à leur faire croire qu’il fallait encore l’augmenter. Vous trouvez pas ça génial ? Tout ça pour le confort de certains partis politiques et pour le confort des « boomers », comme on dit, qui, de ce point de vue-là, considèrent que, ma foi, tout va très bien. »
Il est certes rassurant que le chef du gouvernement soit conscient et s’émeuve de l’énormité d’une dette qui dépasse 3 400 milliards d’euros et ne cesse d’augmenter (même si on l’a peu entendu, lorsqu’il était membre de la majorité présidentielle, critiquer la politique du « quoi qu’il en coûte »…) Il est rassurant aussi qu’il se soucie de l’avenir des jeunes générations, qui devront supporter le poids des intérêts de cette dette, en plus du coût des retraites des aînés dans un système par répartition plombé par le déficit démographique. Le Premier ministre est donc fondé à tirer la sonnette d’alarme.
En revanche, les « boomers » (terme péjoratif désignant les générations nées à l’époque du « baby-boom », comme François Bayrou lui-même…) ont bon dos, même si l’on peut leur reprocher de s’être laissé endormir pendant des décennies par les discours lénifiants des politiciens, toujours réélus. Ces derniers, en dépit des crises économiques survenues à partir de 1973 (année du premier choc pétrolier), ont eu recours à l’endettement public par facilité, au lieu de réaliser à temps les réformes de fond nécessaires. Toutefois, les régimes de retraite du secteur privé (salariés et indépendants) ont fait l’objet de plusieurs réformes paramétriques : celles d’Edouard Balladur en 1993, de François Fillon en 2003, d’Eric Woerth en 2010, de Marisol Touraine en 2014, d’Elisabeth Borne en 2023, qui se sont traduites par des mesures douloureuses.
Par ailleurs, deux éléments de comparaison permettent de mesurer l’évolution négative du rapport entre les cotisations et les pensions dans les régimes des salariés du secteur privé : la chute des taux de remplacement (montant de la retraite par rapport au dernier salaire) et de rendement (montant de rente acheté pour un euro cotisé) dans les régimes des salariés du privé. En l’occurrence, le taux de remplacement pour un salarié du privé percevant le salaire moyen Arrco, est tombé de 71,2 % à 59,9 % entre 2000 et 2020 (Cnav + Agirc-Arrco). Par ailleurs, le taux de rendement net dans le régime complémentaire Agirc-Arrco a chuté de 20 % depuis l’an 2000.
Moyennant ces sacrifices demandés aux affiliés, l’Agirc-Arrco, auquel tout déficit et tout endettement sont d’ailleurs interdits, a pu provisionner 86 milliards d’euros de réserves (soit dix mois et demi de paiement des pensions), dont l’Etat-cigale voudrait s’emparer.
Ces données confirment le pronostic de François Bayrou : sans même parler de la dette publique, si la tendance se poursuit, les jeunes générations finiront par cotiser à perte ! Les propos du Premier ministre n’en restent pas moins irrecevables pour plusieurs raisons. À l’entendre les générations du « baby boom » seraient indistinctement composées de nababs engoncés dans leur « confort », ce qui est loin d’être le cas.
En outre, la responsabilité première de la situation actuelle n’incombe pas aux retraités, mais aux gouvernements qui se sont succédé, sans vouloir procéder à la réforme structurelle que la détérioration très prévisible de la situation exigeait.
Au mois de février dernier, encore, un audit des retraites publié par la Cour des comptes, présidée par l’ancien ministre socialiste de l’Économie Pierre Moscovici, a écarté d’un revers de manche la subvention annuelle de 46 milliards d’euros, déguisée en surcotisations, par laquelle l’Etat « équilibre » avec l’argent des contribuables le régime spécial de ses fonctionnaires : « passez muscade ! », comme on dit au jeu de bonneteau. Or, il s’en faut de loin que les mesures qui ont frappé les retraités du privé se soient appliquées de la même manière dans les régimes spéciaux du public. Les réformes y ont été moins nombreuses et plus tardives que dans le privé, et souvent largement compensées. L’essentiel de leurs coûteux privilèges a été préservé, notamment un taux de remplacement à 75 % au minimum du dernier salaire, que l’Etat garantit nonobstant les déficits béants de ces régimes.
Les politiciens ne peuvent pas s’exonérer de leurs responsabilités. En 2017, Emmanuel Macron s’était engagé à réaliser une grande réforme structurelle, qui établirait l’équité entre tous les Français devant la retraite. Elle a été, depuis, complètement enterrée et le « conclave » imaginé par François Bayrou est même en passe de sonner le glas de la réforme paramétrique d’Elisabeth Borne (une de plus, et qui ne résolvait rien durablement). Depuis près de neuf mois qu’il dirige le gouvernement, le Premier ministre n’a pas fait avancer d’un iota le dossier des retraites et l’échec prévisible du « conclave » risque de se solder, si le « plan » qu’il a finalement présenté est adopté, par de nouvelles ponctions fiscales sur les pensions.
Il est inadmissible que, pour se dédouaner de ce fiasco, le chef du gouvernement use d’un subterfuge aussi grossier qu’une accusation portée contre une partie de la population, au risque de dresser les Français les uns contre les autres, génération contre génération.


